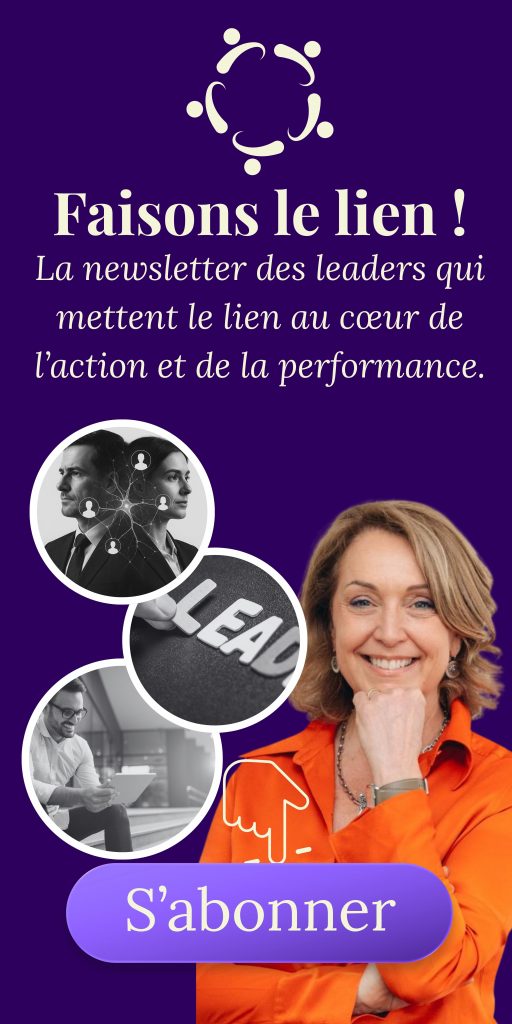Plus qu’un aventurier…
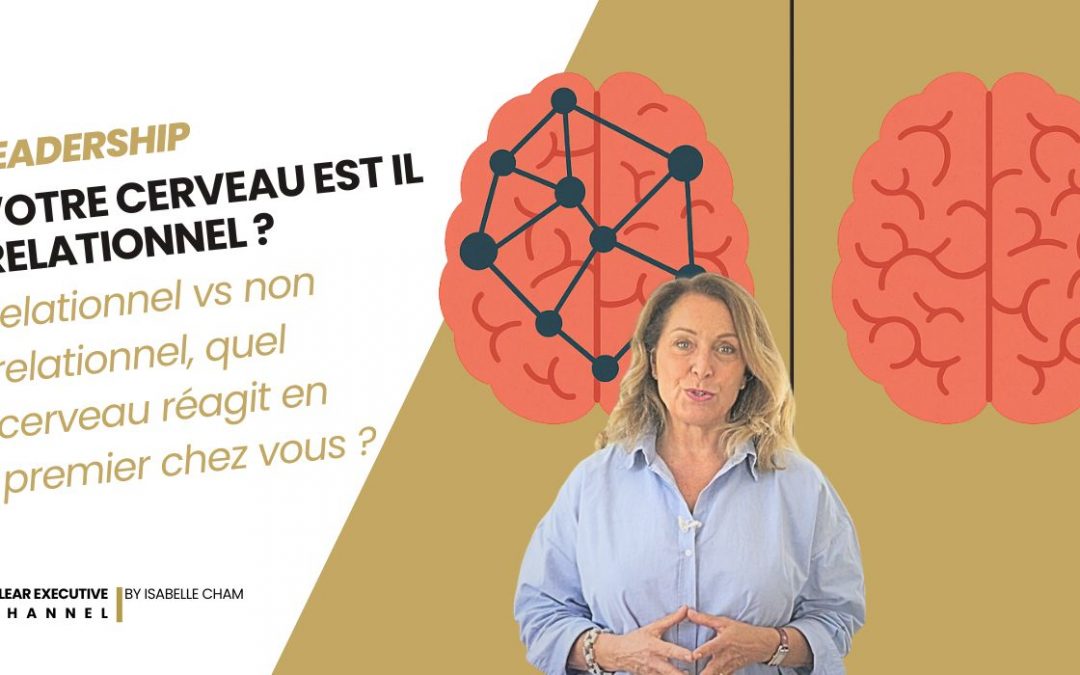
Cerveau relationnel vs non relationnel
Cerveau relationnel vs non relationnel
Lequel vous guide en tant que leader ?
Vous est-il déjà arrivé d’entrer dans une réunion et de sentir que l’atmosphère est lourde… alors que personne n’a encore parlé ? Dans ces moments-là, notre cerveau non relationnel prend souvent le dessus. Il interprète les signaux de travers, déclenche des réflexes défensifs et installe un climat de méfiance. Le problème, c’est que cette réaction abîme vite la confiance. L’engagement s’érode, l’autorité du leader perd en crédibilité, et chacun ressort de la réunion avec un sentiment de malaise.
🎥 Retrouvez l’analyse complète dans la vidéo
Pourquoi le cerveau non relationnel nous piège
Notre cerveau limbique, lorsqu’il perçoit de l’incertitude, agit comme si une menace planait. C’est ce qu’on appelle le phénomène de “l’amygdale hijack” : une prise de contrôle émotionnelle qui pousse à réagir trop vite.
Un silence devient une attaque, un regard fuyant une opposition, un délai une résistance. Or, dans la réalité, ces signes peuvent avoir des causes très différentes : fatigue, besoin de recul, attente d’explications. En restant enfermé dans une lecture défensive, le leader passe à côté du vrai sens de la situation.
Activer son cerveau relationnel
Heureusement, il est possible de réactiver une autre partie de nous-mêmes : le cerveau relationnel. Celui qui lit les signaux faibles, qui accueille l’incertitude sans crispation et qui transforme les malentendus en opportunités d’ouverture. Trois réflexes simples permettent déjà de changer la donne :
1. Suspendre le réflexe défensif
Avant de réagir, prendre 3 secondes de silence. Ce court délai suffit à calmer la réaction instinctive et à reprendre la main avec plus de lucidité.
2. Observer les signaux faibles
70 % de notre communication est non verbale. Postures, silences, regards… ces micro-indices sont souvent bien plus fiables que les mots.
3. Transformer ses réactions en questions
Au lieu de penser “ils sont contre moi”, demander “Qu’est-ce qui est important pour vous dans cette situation ?” Cette ouverture désamorce la méfiance et restaure la confiance.
Pourquoi c’est un enjeu de leadership
Développer son cerveau relationnel n’est pas un luxe. Dans un monde saturé d’incertitudes, c’est un levier stratégique. Un leader capable de lire juste les dynamiques relationnelles influence mieux, entraîne davantage ses équipes et garde intacte la confiance qui lui est accordée.
✍️ Et maintenant ?
La prochaine fois que vous entrez en réunion, posez-vous une question simple :
Est-ce mon cerveau relationnel ou mon cerveau non relationnel qui prend le dessus ?
La différence peut sembler subtile, mais elle transforme profondément votre impact.
🎥 Pour aller plus loin, découvrez ma vidéo complète sur le sujet 👆
👀 Si vous souhaitez explorer votre profil relationnel découvrez mes analyses iR personnalisées.
Pour aller plus loin
📩 Envie d’échanger en direct sur mes solutions ou conférences ? Contactez-moi ici.
📬 Pour recevoir mes prochaines réflexions en avant-première : abonnez-vous à ma newsletter mensuelle.
👉 En savoir plus sur mes accompagnements