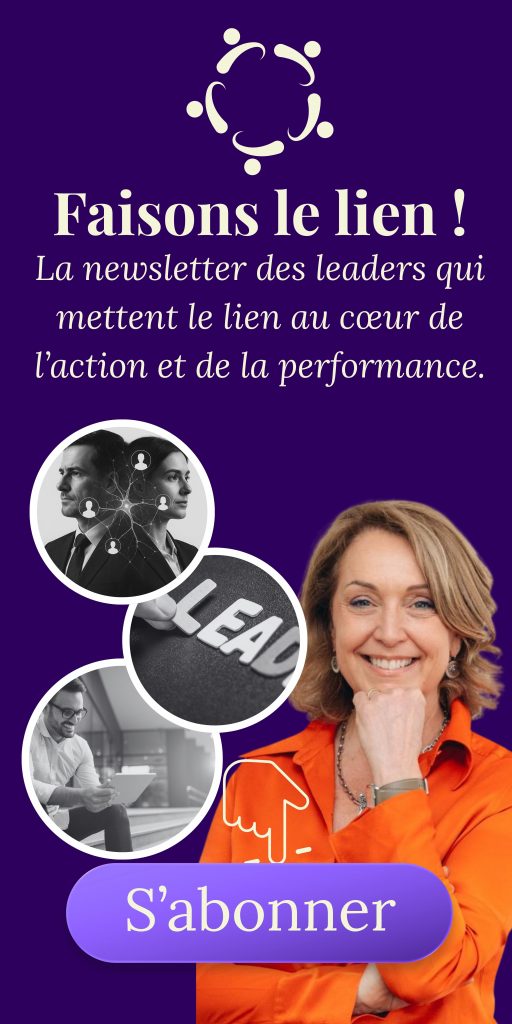Réinventer l’imaginaire du pouvoir : vers une autorité relationnelle
L’été est souvent ce moment suspendu où le bruit du monde se fait plus lointain. Pour moi, il devient aussi un moment de recul pour observer à distance l’actualité politique et ce qu’elle dit de notre rapport au pouvoir.

Ces dernières années, dans mon travail et mes recherches sur le leadership, dans la vie civile et dans mon ouvrage Diriger avec intention, j’ai vu émerger des figures qui tentent de réconcilier puissance et justesse, action et sens, stratégie et alignement. Un leadership intentionnel, relationnel, exigeant, qui fait écho aux défis complexes de notre époque.
Il faut cependant bien le reconnaître : ces efforts peinent à s’imposer et les figures que je mets généralement en avant pour illustrer mes propos, dans mes conférences ou mes articles, restent malgré leurs qualités remarquables, des pionniers, alors même que notre XXIᵉ siècle appelle de toute urgence une transformation plus profonde.
Ce que je vois, comme beaucoup de contemporains lucides, c’est d’abord un monde politique, de plus en plus imbriqué avec des entreprises tentaculaires, recherchant avant tout la domination, et reléguant les efforts citoyens précités au second plan. Le tout, sous couvert de vouloir « rassurer » face à l’incertitude, de « simplifier » un réel devenu trop complexe pour des citoyens désarmés… mais qui, au fond, consiste surtout à les mettre sous contrôle, progressivement mais sûrement.
Ce pouvoir dominant, qui s’emploie à restaurer ici et là une virilité binaire, spectaculaire et crispée, s’acharne dans le même temps à disqualifier toute tentative de réintroduire l’empathie ou le care dans le débat public, les taxant de « douceur inefficace », de « manque de lucidité », de « moralisme émotionnel ».
Pourtant, il existe une troisième voie. Une voie que je défends et que je travaille depuis des années : celle de l’autorité relationnelle. Ni défensive, ni naïve, cette forme d’autorité incarne une possible évolution du débat public, mais aussi de la pensée politique contemporaine, et peut-être même de nos démocraties.
Elle seule, me semble-t-il, peut nous aider à transformer les révolutions, les mutations, les impasses de l’époque, en leviers de sociétés avancées, au lieu de ces replis régressifs qui fleurissent ici et là, nous faisant perdre un temps considérable pour construire des sociétés en lien avec les défis que nous traversons.
La crise du pouvoir viril : une force qui se fige
Notre époque semble fascinée par le retour du « chef », du « père », du gladiateur : figures verticales, protectrices, souvent brutales. Trump, Modi, Poutine, Bolsonaro, plusieurs dirigeants européens aussi, incarnent cette réactivation d’un imaginaire du pouvoir basé sur la force, l’exclusion, l’affirmation sans nuance.
Cette posture fonctionne temporairement : elle rassure dans le chaos, elle donne l’illusion d’un cap mais elle le fait au prix d’un appauvrissement du lien : écoute quasi inexistante, débats vidés d’altérité, slogans sans subtilité, dialogues réduits à de la diplomatie spectacle.
En réalité, ce pouvoir viril se fige sur lui-même en s’auto-alimentant d’artefacts de pouvoir. Ce faisant il entraîne aussi le débat public à se figer. En étant systématiquement défensif, incapable d’affronter la complexité du réel autrement qu’en recourant au contrôle, à la menace répétée d’un danger invisible ou à une mise en scène digne de la téléréalité déshumanisante, il provoque autant la résistance des non-partisans que la neutralisation des débats d’envergure.
À cela, certains tentent de se défendre par l’apologie de l’empathie ou d’introduire davantage de bienveillance, d’humanité, d’émotion. Mais ils se heurtent à une réalité qui avance plus vite et qui ne se laisse pas ralentir par des postures symboliques ou émotionnelles.
Le registre affectif, seul, ne constitue pas un contrepoids suffisant à la rigidité du pouvoir politique actuel. Il prête même plutôt le flanc, en passant pour un discours doux ou compatissant ; traduisez : inefficace, voire déconnecté.
Pire encore : lorsqu’il est féminisé, il devient suspect. Et même lorsqu’il ne l’est pas, il reste souvent relégué à une posture morale ou privée, donc disqualifié dans l’arène publique. Cette tension conduit à une impasse : soit on est fort et dominateur, soit on est doux et marginal… Sauf à envisager d’autres voies.
La troisième voie… l’ère de l’autorité relationnelle
La relation ne consiste ni à dominer ni à séduire, mais à relier avec lucidité dans la complexité. Elle repose sur un principe simple mais fondateur : le pouvoir ne se décrète pas. Il se tisse. Il se construit dans la qualité du lien.
C’est là que s’ouvre un chemin trop peu exploré : celui de l’intelligence relationnelle comme matrice d’une autre forme d’autorité. Une autorité ni molle ni spectaculaire, mais structurante. Qui permet de poser des actes clairs sans brutaliser, de prendre des décisions fortes sans exclure, d’imposer des limites sans humilier.
Une autorité qui ne s’appuie pas sur la peur, mais sur la cohérence. Sur l’alignement entre ce que l’on est, ce que l’on dit et ce que l’on fait.
Ce que j’appelle l’autorité relationnelle, c’est la capacité à être un repère sans être un repoussoir.
C’est une forme de pouvoir qui ne cherche pas à contrôler les individus, mais à structurer un espace commun dans lequel chacun peut agir avec sens, responsabilité et conscience.
Et c’est peut-être cela, aujourd’hui, le plus subversif.
Une transformation silencieuse… mais bien en marche
À première vue, cette autorité relationnelle semble absente du paysage politique et pourtant, quelque chose est en train de bouger, en profondeur. Une transformation silencieuse, portée à la fois par certains responsables publics, des mouvements citoyens ou des initiatives entrepreneuriales.
On a beaucoup parlé de Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande de 2017 à 2023, pour sa posture à la fois ferme et profondément incarnée. Son attitude après l’attentat de Christchurch, son discours de solidarité, ses décisions rapides et éthiques, son départ volontaire du pouvoir : tout cela formait un modèle d’autorité relationnelle publique.
Mais elle n’est pas la seule.
expérimenté pendant des années une démocratie participative fondée sur l’écoute, la construction collective et la délibération réelle, bien loin du théâtre de la concertation.
Et demain ? D’autres figures vont émerger. Des leaders inattendus, issus du monde associatif, de l’enseignement, de la culture, de l’entreprise à impact. On les trouvera dans des collectifs citoyens qui remettent en question l’organisation du travail, dans des entreprises qui repensent la gouvernance, dans des lieux de réflexion hors des circuits classiques. Ce sont des architectes de lien, souvent invisibles, mais déjà à l’œuvre.
Pour moi, le vrai verrou repose sur le fait que ces exemples ne sont pas suffisamment valorisés pour venir nourrir nos récits collectifs. A force de mettre en avant les frasques verbales ou événementiels de politiques à la recherche d’effets superlatifs, via les algorithmes ou l’actualité en boucle, nos sociétés ne peut reconnaître dans ces modèles courageux et cohérents, une voie pour réinventer profondément les modèles politiques actuels.
En les reconnaissant comme de vrais leaders politiques, que l’on n’admire pas seulement à la marge, en les qualifiant d’exceptions, on permettrait ainsi de leur donner la vraie place qu’ils méritent : celles de réformateurs profonds de l’exercice du pouvoir politique ou civile.
Tant que tout autour de nous, dans les médias, à l’école, dans les séries, dans le monde du travail, on continue de présenter le pouvoir comme quelque chose de vertical, viril, spectaculaire, on continue d’associer le leadership à la parole qui écrase, au geste qui tranche, à la posture qui impressionne. Dans ce cadre-là, une autorité relationnelle, lucide, posée, construite sur la confiance, n’a pas de place. Elle semble “sympa” mais pas “stratégique”. Ou “morale” mais localement “efficace”. Alors on applaudit ces figures quand elles passent… et l’on se dépêche de les classer au rayon « d’exceptions historiques », au lieu de les valoriser comme une autre manière de faire autorité.
Tant que l’on ne changera pas ce que l’on valorise, ce que l’on raconte, ce que l’on transmet, ce que l’on enseigne, ces formes d’autorité resteront marginales et ceux qui les incarnent, continueront de se heurter à un mur : pas de récit, pas de reconnaissance.
Pour une nouvelle grammaire du pouvoir
Il est temps de réinventer notre vocabulaire politique ; de sortir du couple usé “fermeté ou faiblesse”, “charisme ou douceur”, “chef ou victime”.
Il nous faut de nouveaux mots pour une nouvelle ère. En voici un florilège : n’hésitez pas à compléter…
- Autorité relationnelle
- Fierté tranquille
- Influence lucide
- Puissance d’alignement
- Leadership de structure intérieure
Il nous faut aussi une éducation du lien : à l’école, dans les entreprises, dans les institutions publiques. Une culture du débat, de la limite, de la complexité, qui ne soit pas une guerre d’opinions mais un apprentissage collectif de la responsabilité.
Il ne s’agit pas d’être gentil. Il s’agit d’être clair.
Réinventer l’imaginaire du pouvoir, ce n’est pas rêver naïvement d’un autre monde. C’est commencer, ici et maintenant, à valoriser d’autres figures, d’autres postures, d’autres mots.
C’est élargir notre vision du leadership pour y intégrer la lucidité, la cohérence, la capacité à relier dans la complexité.
C’est reconnaître, au-delà du bruit, ceux et celles qui font autorité autrement et qui, ce faisant, redonnent sens à l’action publique.
Il ne s’agit pas de remplacer un modèle par un autre mais d’ouvrir une brèche dans le récit dominant, pour qu’une pluralité de formes d’autorité puisse émerger, circuler, inspirer.
La capacité à créer du lien, nous a permis de faire société, de développer des cultures, de transmettre des pensées, de réinventer des époques… En quoi en serait-il aujourd’hui différemment face aux défis que nous traversons ?

Pour aller plus loin
📩 Envie d’échanger en direct sur mes solutions ou conférences ? Contactez-moi ici.
📬 Pour recevoir mes prochaines réflexions en avant-première : abonnez-vous à ma newsletter mensuelle.
👉 En savoir plus sur mes accompagnements

Leçons inattendues (et drôles) pour les leaders d’aujourd’hui
Mieux vaut en rire … quoique !